Un nouvel entretien autour de l’informatique. Anne Canteaut est une chercheuse française en cryptographie de l’Inria (Institut national de recherche en sciences et technologues du numérique). Ses recherches portent principalement sur la conception et l’analyse d’algorithmes cryptographiques symétriques. Elle a reçu en 2023 le Prix Irène-Joliot-Curie de la Femme scientifique de l’année. Elle a été élue en 2025 à l’Académie des sciences.

Binaire : Pourrais-tu nous raconter comment tu es devenue une chercheuse de renommée internationale de ton domaine ?
AC : Par hasard et par essais et erreurs. Longtemps, je n’ai pas su ce que je voulais faire. En terminale, j’ai candidaté dans des prépas à la fois scientifiques et littéraires. J’ai basculé côté scientifique par paresse, parce que cela demandait moins de travail. Après la prépa scientifique, la seule chose que je savais, c’était que je ne voulais pas faire d’informatique. Je voyais l’informatique comme un hobby pour des gars dans un garage qui bidouillent des trucs en buvant du coca et en mangeant des pizzas ; très peu pour moi. J’ai découvert l’informatique à l’ENSTA : une science comme les maths ou la physique, et pas du bricolage.
J’aimais beaucoup les maths. Alors, j’ai réalisé un stage de maths « pures » et je me suis rendu compte que le côté trop abstrait n’était pas pour moi. Faire des raisonnements sur des objets que l’on pouvait manipuler plus concrètement, comme on le fait en informatique, me convenait bien mieux. J’ai fait ma thèse à l’Inria-Rocquencourt, un postdoc à l’ETH à Zurich, puis j’ai été recrutée à l’Inria où j’ai fait toute ma carrière, sauf une année sabbatique au Danemark. A l’Inria, j’ai été responsable d’une équipe nommée Secret, déléguée scientifique[1] du Centre de Paris et présidente de la commission d’évaluation[2] d’Inria pendant 4 ans.
Binaire : Peux-tu nous parler de ton sujet de recherche ?
AC : Je suis cryptographe. La cryptographie a de nombreuses facettes. Dans une messagerie chiffrée ou un protocole de vote électronique comme Belenios, on trouve différents éléments cryptographiques élémentaires, et puis on les combine. J’aime bien la comparaison que fait Véronique Cortier[3]. Dans une bibliothèque IKEA, on part de planches, et d’une notice de montage. Celui qui fait la notice suppose que les planches sont bien faites et explique comment construire la bibliothèque en assemblant les planches. Dans le cadre de la cryptographie, mon travail consiste à réaliser des planches aussi parfaites que possible pour qu’elles puissent être utilisées par des collègues comme Véronique Cortier dans leurs notices. Les planches, ce sont les blocs cryptographiques de base. Les notices, ce sont, par exemple, les protocoles cryptographiques.
Le chiffrement est un de ces blocs de base. J’ai surtout étudié le « chiffrement symétrique ». Il suppose que deux interlocuteurs partagent un même secret (une clé) qu’ils utilisent pour s’envoyer un message très long. Du temps du téléphone rouge entre la Maison Blanche et le Kremlin, la clé était communiquée par la valise diplomatique, un canal de communication fiable qui ne peut pas être intercepté. Cela permettait de s’échanger des clés très longues. Aujourd’hui, on veut pouvoir communiquer une clé (une chaine de bits) de manière confidentielle sans disposer de valise diplomatique. Plutôt que de se passer « physiquement » une clé, on utilise un chiffrement asymétrique, ce qui nous oblige à utiliser des clés relativement courtes. Dans ces protocoles asymétriques, on dispose d’une clé publique et d’une clé privée. Tout le monde peut m’envoyer un message en le chiffrant avec la clé publique ; il faut détenir la clé privée pour pouvoir le déchiffrer. Le problème est que ce chiffrement asymétrique est très coûteux, alors on envoie la clé d’un chiffrement symétrique, et on passe ensuite à un chiffrement symétrique qui est bien moins coûteux.
Dans tous les cas, le problème central est « combien ça coûte de casser un chiffrement, c’est-à-dire de décrypter un message chiffré, ou encore mieux de retrouver la clé secrète ? ». Quel est le coût en temps, en mémoire ? Comment peut-on utiliser des informations annexes ? Par exemple, que peut-on faire si on dispose de messages chiffrés et de leurs déchiffrements (le contexte de la pierre de Rosette[4]) ?
Binaire : Tu te vois plutôt comme conceptrice de chiffrement ou comme casseuse de code ?
AC : On est toujours des deux côtés, du côté de celui qui conçoit un système de chiffrement assez sûr, et du côté de celui qui essaie de le casser. Quand on propose une méthode de chiffrement, on cherche soi-même à l’analyser pour vérifier sa solidité, et en même temps à la casser pour vérifier qu’elle ne comporte pas de faiblesse. Et, quand on a découvert une faiblesse dans une méthode de chiffrement, on cherche à la réparer, à concevoir une nouvelle méthode de chiffrement.
Comme l’art minimaliste, la crypto minimaliste
Il faut bien sûr contenir compte du contexte. J’ai par exemple travaillé sur des méthodes de chiffrements quand on dispose de très peu de ressources énergétiques. Dick Cheney, ancien vice-président états-uniens, avait un implant cardiaque, un défibrillateur. Il craignait une cyberattaque sur son implant et avait obtenu de ses médecins de désactiver son défibrillateur pendant ses meetings publics. Pour éviter cela, on est conduit à sécuriser les interactions avec le défibrillateur, mais cela demande d’utiliser sa pile, donc de limiter sa durée de vie. Cependant, changer une telle pile exige une opération chirurgicale. Sujet sérieux pour tous les porteurs de tels implants ! La communauté scientifique a travaillé pendant des années pour concevoir un système de chiffrement protégé contre les attaques et extrêmement sobre énergétiquement. Un standard a finalement été publié l’an dernier. J’appelle cela de la crypto minimaliste. Pour faire cela, il a fallu interroger chaque aspect du chiffrement, questionner la nécessité de chaque élément pour la sécurité.
Binaire : Tu as travaillé sur le chiffrement homomorphe. Pourrais-tu nous en parler ?
AC : Chiffrer des données, c’est un peu comme les mettre dans un coffre-fort. Le chiffrement homomorphe permet de manipuler les données qui sont dans le coffre-fort, sans les voir. On peut par exemple effectuer des recherches, des calculs sur des données chiffrées sans avoir au préalable à les déchiffrer, par exemple pour faire des statistiques sur certaines d’entre elles.
On a besoin de combiner ces techniques homomorphes, avec du chiffrement symétrique. Problème : les gens qui font du chiffrement homomorphe ne travaillent pas avec des nombres binaires. Par exemple, ils peuvent travailler dans le corps des entiers modulo p, où p est un nombre premier. Dans le monde de la cryptographie symétrique, nous travaillons habituellement en binaire. On n’a pas envie quand on combine les deux techniques de passer son temps à traduire du codage de l’un à celui de l’autre, et vice versa. Donc nous devons adapter nos techniques à leur codage.
On rencontre un peu le même problème avec les preuves à minimum de connaissance (zero-knowledge proofs). Nous devons adapter les structures mathématiques des deux domaines.
Binaire : Tu es informaticienne, mais en fait, tu parles souvent de structures mathématiques sous-jacentes. Les maths sont présentes dans ton travail ?
AC : Oui ! Maths et informatique sont très imbriquées dans mon travail. Une attaque d’un système cryptographique, est par nature algorithmique. On essaie de trouver des critères pour détecter des failles de sécurité. Résister à une attaque de manière « optimale », ça s’exprime généralement en se basant sur des propriétés mathématiques qu’il faut donc étudier. On est donc conduit à rechercher des objets très structurés mathématiquement.
Le revers de la médaille c’est que quand on a mis dans le système un objet très structuré mathématiquement, cette structure peut elle-même suggérer de nouvelles attaques. Vous vous retrouvez avec un dialogue entre les maths (l’algèbre) et l’informatique.
Binaire : Peux-tu nous donner un exemple de problème mathématique que vous avez rencontré ?
AC : Une technique de cryptanalyse bien connue est la cryptanalyse différentielle. Pour lui résister, une fonction de chiffrement doit être telle que la différence f(x+d)-f(x), pour tout d fixé, soit une fonction (dans le cadre discret) dont la distribution soit proche de l’uniforme. Cela soulève le problème mathématique : existe-t-il une fonction f bijective telle que chaque valeur possible des différences soit atteinte pour au plus deux antécédents x (ce qui est le plus proche de l’uniforme que l’on puisse atteindre en binaire) ?
Même sans avoir besoin de comprendre les détails, vous voyez bien que c’est un problème de math. Que sait-on de sa solution ? Pour 6 bits, on connait une solution. Pour 8 bits, ce qui nous intéresse en pratique, on ne sait pas. Une réponse positive permettrait d’avoir des méthodes de chiffrement moins coûteuses, donc des impacts pratiques importants. Des chercheurs en math peuvent bosser sur ce problème, chercher à découvrir une telle fonction, sans même avoir besoin de comprendre comment des cryptographes l’utiliseraient.
Binaire : Les bons citoyens n’ont rien à cacher. Depuis longtemps, des voix s’élèvent pour demander l’interdiction de la cryptographie. Qu’en penses-tu ?
AC : Le 11 septembre a montré que les terroristes pouvaient utiliser les avions à mauvais escient, et on n’a pas pour autant interdit les avions. D’abord, il faut avoir en tête que la crypto sert aussi à protéger les données personnelles, et les données des acteurs économiques. Ensuite, comment fait-on pour interdire l’usage de la cryptographie ? Comme fait-on pour interdire un algorithme ?
Il faut comparer, en informatique aussi, les avantages et les inconvénients d’une utilisation particulière. On le fait bien pour les médicaments en comparant bénéfices et effets secondaires. Pour prendre un exemple, dans un lycée que je connais, il a été question de remplacer le badge de cantine par une identification biométrique (lecture de la paume de la main). J’ai préféré payer quelques euros de plus pour garder le badge et ne pas partager des informations biométriques stockées on ne sait où par on ne sait qui. Dans ce cas, les avantages me semblaient clairement inférieurs aux risques.
Binaire : As-tu quelque chose à dire sur l’attractivité de l’informatique pour les femmes ? Comment expliques-tu le manque d’attractivité, et vois-tu des solutions ?
AC : Côté explication, mon point de vue découle de mon expérience personnelle. Il y a des problèmes à tous les niveaux des études, mais un aspect crucial est que, encore maintenant en 2025, on enseigne très peu l’informatique au collège et au lycée. Du coup, comme les jeunes savent mal ce que c’est, ils se basent sur l’image renvoyée par la société : l’informatique est pour les hommes, pas pour les femmes. Même les déjà rares jeunes femmes qui commencent une spécialité NSI [5] abandonnent la voie informatique dans des proportions considérables. Elles imaginent que l’informatique tient d’une culture « geek » très masculine, et que cela donne donc une supériorité aux hommes.
Le problème est assez semblable en math. Il est superbement traité dans le livre « Matheuses », aux Éditions du CNRS.
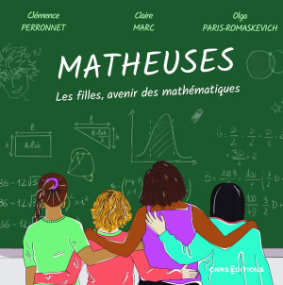
Je ne vois pas de solution unique. Mais, par exemple, peut-être faudrait-il revoir la part trop importante accordée au volontariat. Les filles candidatent moins ; à compétence égale, elles sont moins inclines à se mettre en avant. Ça peut aller de se présenter aux Olympiades de maths au lycée, jusqu’à faire une demande de prime au mérite dans un institut de recherche. C’est pourquoi les candidatures au concours de cryptanalyse Alkindi, destiné aux élèves de collège et de lycée, ne se basent pas entièrement sur le volontariat. Ce n’est pas un élève d’une classe qui participe, mais toute la classe. Résultat : parmi les gagnants, il y a autant de filles que de garçons.
Binaire : tu viens d’être élue à l’Académie des sciences, tu as eu le prix Irène-Joliot-Curie. Comment vis-tu ces reconnaissances des qualités de tes recherches ?
AC : Je suis évidemment très flattée. Mais je crains que cela donne une image faussée de la recherche, beaucoup trop individuelle. La recherche dans mon domaine est une affaire éminemment collective. J’ai écrit très peu d’articles seule. Pour obtenir des résultats brillants dans le domaine du chiffrement qui est le mien, on a vraiment besoin d’une grande diversité de profils, certains plus informaticiens et d’autres plus mathématiciens. D’ailleurs, c’est vrai pour la recherche en informatique en général. C’est plus une affaire d’équipes, que d’individus.
Serge Abiteboul, Inria ENS, Paris, Claire Mathieu, CNRS et Université Paris Cité
[1] Assure la coordination scientifique du centre.
[2] Plus importante instance scientifique d’Inria au niveau national.
[3] Véronique Cortier contribue régulièrement à binaire.
[4] La pierre de Rosette est un fragment de stèle gravée de l’Égypte antique portant trois versions d’un même texte qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes au XIXe siècle. [Wikipédia]
[5] La spécialité NSI, numérique et sciences informatiques, est une spécialité offerte en première générale et éventuellement poursuivie en terminale. Les chiffres sont mauvais pour les garçons et catastrophiques pour les filles. Voir https ://www.socinfo.fr/uploads/2024/06/2024-05-31-NSI-2023-perilenlademeure.pdf]
https://binaire.socinfo.fr/les-entretiens-de-la-sif/


Laisser un commentaire