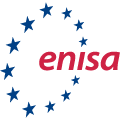Binaire : Vous êtes directeur d’un grand laboratoire d’informatique. Dans quels domaines vos équipes développent-elles des travaux que vous considérez comme sensibles ?

Il est difficile de le dire : à la fois aucun, et tous ! Le principe général, quand on fait de la recherche, est qu’on ne sait pas à l’avance ce qui va déboucher et ce qui n’aboutira pas. On peut très bien travailler sur un sujet pas spécialement secret, et obtenir des résultats sensibles que l’on n’avait pas prévus au départ. Dans le cas de l’IRISA, un très gros laboratoire dont les thématiques couvrent tous les champs de l’informatique jusqu’à l’image ou la robotique, identifier les risques est une mission impossible.
Il y a un exemple célèbre : la technologie des processeurs ARM, qui équipent la vaste majorité des téléphones mobiles dans le monde. Autant dire, un succès industriel d’une ampleur peu commune, une technologie (européenne d’ailleurs) qui vaut des milliards. Le point fort de ces processeurs est d’être très peu consommateurs en énergie. Et pourtant, ce n’est pas du tout dans ce but qu’ils ont été initialement conçus ! Le futur inventeur des ARMs travaillait sur tout autre chose, il avait simplement besoin de processeurs pour ses travaux. Intel ayant refusé de lui en fournir, il a conçu un processeur qu’il voulait le plus simple possible. Ce n’est qu’au moment de tester ces nouveaux processeurs qu’on a constaté qu’ils consommaient très peu d’énergie. Voilà un exemple, entre mille, de technologie ultra sensible, pas du tout imaginée comme telle. Bref, dans un laboratoire, il faut être prêt à tout.
B : Quels sont les risques qui vous inquiètent le plus ?
On pense facilement au piratage informatique, mais en réalité, ce qui me semble le plus délicat est le pillage des cerveaux. C’est particulièrement vrai pour un laboratoire d’informatique. Dans notre cas, ce qui compte, ce sont les idées. Les artefacts que sont les logiciels, articles ou brevets n’ont pas une si grande importance. Les logiciels conçus par nos chercheuses et chercheurs sont souvent open source, c’est-à-dire que leur code est accessible en clair sur internet. Rien de plus facile que de les récupérer : il suffit de copier coller ! Le concept de vol pour un logiciel open source est donc tout-à-fait singulier.
S’en servir intelligemment est en revanche une toute autre affaire, qui peut requérir un très fort investissement. La difficulté est de modifier le code pour lui faire faire ce que l’ont veut. Pour cela, il faut en pratique avoir sous la main les gens qui ont conçu le logiciel.
B : Ce pillage des cerveaux, vous l’estimez de quelle ampleur dans le cas de l’IRISA ?
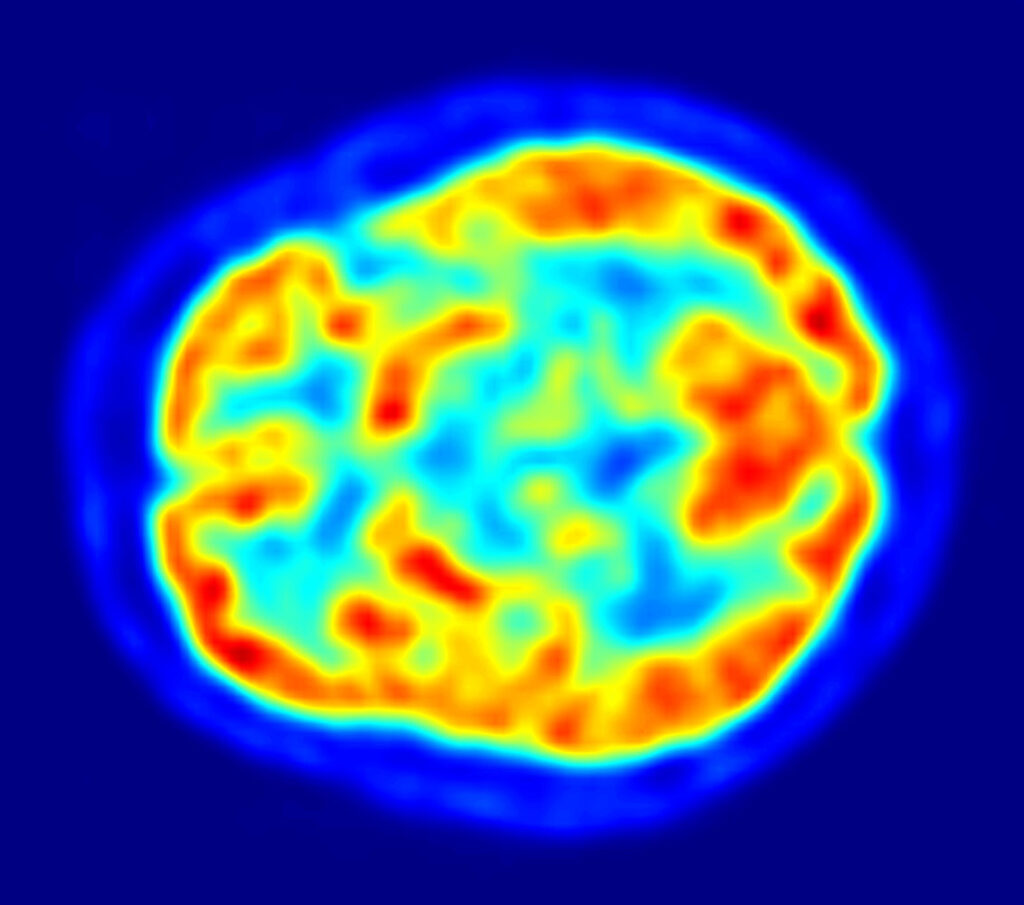
Nous avons environ 850 membres du laboratoire, dont 350 doctorants et post-doctorants. Chaque année, les départs représentent 1 à 3 fonctionnaires et environ 200 contractuels (ingénieurs, post-doctorants et doctorants). Certains sont embauchés dans des multinationales de l’informatique comme Google ou Facebook ; c’est à la fois une reconnaissance de la qualité de nos personnels, et une frustration.
Il y a là une vraie difficulté. Naturellement, parce que c’est bien une des voies privilégiées du transfert de la recherche vers la société, nos anciens doctorants et post-docs vont irriguer d’autres labos en France ou à l’étranger, ou le monde économique. Tout à fait légalement, une entreprise ou une agence non européenne peut donc recruter ces experts de haut niveau, et achètent en réalité leurs compétences.
B : Peut-on aussi voler les idées, sans même embaucher le cerveau qui les a eues ou développées ?
Oui, c’est possible. La recherche se fait de nos jours sous une forme contractuelle et compétitive. Les chercheurs doivent soumettre leurs meilleurs projets de recherche, donc des idées pas encore développées, à des jurys souvent internationaux. Cela représente un problème potentiel : on peut imaginer que sur des sujets de recherche appliqués à la défense par exemple, certains membres de ces jurys internationaux ne soient pas totalement neutres.
Et sans même aller jusque là, le principe reste de donner ses meilleures idées à des équipes concurrentes. Il y a bien sûr des règles de déontologie. Malgré tout, les membres du jury ont accès au projet. S’ils sont malhonnêtes, ils peuvent assez facilement démolir le projet et s’en approprier les idées. Même s’ils sont honnêtes, dans la mesure où ils sont du même domaine, ils repartent forcément influencés par les projets auxquels ils ont eu accès : on ne peut pas oublier des idées ! Parfois, on peut identifier des cas litigieux, mais souvent on ne le voit même pas.
B : Alors finalement, le piratage informatique n’est pas le souci d’un laboratoire d’informatique ?

CC BY-SA 2.0 fr
Pas tant que ça. Il y a parfois des tentatives d’intrusions sur nos systèmes, mais peu réussissent – d’ailleurs, même quand elles réussissent, elles ne touchent que des choses périphériques, un site web défiguré par exemple : les dégâts sont franchement anecdotiques. Nous avons quelques cas chaque année. En quelques dizaines d’années, nous n’avons jamais eu d’intrusion directe de notre réseau, jamais. Nous avons des équipes compétentes, très vigilantes sur ce sujet.
Dans une autre catégorie, nous avons aussi chaque année une dizaine de cas de vols d’ordinateurs, souvent dans une gare ou un train, ce qui fait penser que ces vols ne sont pas forcément ciblés. Malgré tout, quand ces ordinateurs contiennent des données sensibles du laboratoire, il est important que celles-ci aient été chiffrées !
B : Vous hébergez des données particulièrement sensibles ? Comment les protégez-vous ?
Nous avons quelques bases de données sensibles, oui : par exemple, une base de données de virus informatiques particulièrement virulents. Nous les protégeons avec des procédures spéciales, mais je ne vais pas vous les décrire ! Nos partenaires comprennent qu’ils peuvent nous faire confiance.
B : Dans votre lettre, vous protestez contre les dispositifs de protection des recherches dans les laboratoires publics. Pourquoi les estimez-vous inadaptés ?

By Arnaud 25 – Own work, CC BY-SA 3.0
D’abord, elles reposent sur une échelle de dangers, déclinée en fonction des risques économiques, en matière de défense ou de terrorisme. Mais comme je vous disais, il est extrêmement difficile de caractériser objectivement le niveau de risque d’une recherche donnée à un moment donné.
En outre, les protections mises en place sont complètement inadaptées au fonctionnement d’un laboratoire moderne. Si je m’en tenais aux dispositifs de protection recommandés, nous pourrions quasiment laisser notre base de virus en clair sur le réseau, à condition de mettre une étiquette sur la porte de la salle du serveur ! C’est totalement inadapté.
Par ailleurs, ces dispositifs induisent des contraintes qui grèvent notre fonctionnement. Un exemple très concret : lorsque nous recrutons quelqu’un, son dossier doit être approuvé par un fonctionnaire extérieur au laboratoire. Cela ajoute un délai pouvant aller jusqu’à deux mois à toute embauche. Or, le marché de l’emploi scientifique est très tendu, en particulier dans le domaine de l’informatique. Les candidats attendent une réponse ferme et rapide, faute de quoi ils vont voir ailleurs. A cause de ces délais imprévisibles, nous ne pouvons jamais nous engager directement auprès des candidats et nous perdons d’excellentes candidatures.
Dans un labo d’informatique, le besoin de protection est très spécifique, car notre objet de recherche est numérique, donc immatériel. On comprend bien que des mesures de protection calibrées sur l’idée d’une usine d’explosifs ne s’appliquent pas directement.
B : Mais est-ce que vous n’auriez pas protesté, quel que soit le dispositif de protection mis en place ?
Il y a une contradiction intrinsèque à vouloir protéger des travaux de recherche, c’est certain. La recherche fonctionne par échanges. Les idées émergent toujours entre les personnes, si possible venant d’horizons différents. Les cerveaux géniaux ne sont d’ailleurs ni nécessaires ni suffisants – l’échange des idées l’est. La liberté de mouvement est donc constitutive de la recherche. Mais nous ne vivons pas dans un monde de bisounours ! Nous sommes bien conscients d’avoir besoin de protection, d’ailleurs, nous avons de nous-mêmes pris des mesures en ce sens. Simplement, les dispositifs qui nous sont imposés par l’État ne sont pas adaptés dans leur forme actuelle. Non seulement ils ne nous protègent pas réellement comme il le faudrait, mais ils nous empêchent de fonctionner efficacement dans le monde extrêmement compétitif de la recherche internationale. Ce serait pour les laboratoires français comme d’essayer de courir le 100m avec un boulet face à des concurrents internationaux sans entrave.



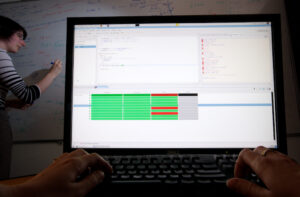






 On le sait, un des meilleurs moyens de se prémunir contre les cyberattaques est de mettre à jour sa machine, le plus vite possible, PC, laptop ou smartphone. Mais a-t-on déjà songé à la complexité du mécanisme de mise à jour pour le fabricant ou pour le concepteur du système d’exploitation ou du logiciel ? Il doit y veiller au niveau mondial et pour des centaines de millions d’utilisateurs. Dans le cas de systèmes d’exploitation très utilisés, la mise à jour, suite à un bug ou une vulnérabilité, doit parfois couvrir l’ensemble des versions, qui ont été produites avec cette vulnérabilité. Que faut-il faire ? Privilégier la version la plus récente et ainsi protéger la grande majorité des clients (mais en rendant vulnérables les utilisateurs de versions antérieures) ou attendre que la correction soit prête pour toutes les versions (un délai supplémentaire mis à profit par les hackers) ?
On le sait, un des meilleurs moyens de se prémunir contre les cyberattaques est de mettre à jour sa machine, le plus vite possible, PC, laptop ou smartphone. Mais a-t-on déjà songé à la complexité du mécanisme de mise à jour pour le fabricant ou pour le concepteur du système d’exploitation ou du logiciel ? Il doit y veiller au niveau mondial et pour des centaines de millions d’utilisateurs. Dans le cas de systèmes d’exploitation très utilisés, la mise à jour, suite à un bug ou une vulnérabilité, doit parfois couvrir l’ensemble des versions, qui ont été produites avec cette vulnérabilité. Que faut-il faire ? Privilégier la version la plus récente et ainsi protéger la grande majorité des clients (mais en rendant vulnérables les utilisateurs de versions antérieures) ou attendre que la correction soit prête pour toutes les versions (un délai supplémentaire mis à profit par les hackers) ?










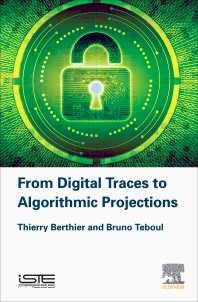 Pour aller plus loin, il faudra attendre :
Pour aller plus loin, il faudra attendre :