Stéphane Grumbach est directeur de recherche à Inria et enseignant à Sciences Po. Il a été directeur de l’IXXI, l’institut des systèmes complexes de la Région Auvergne Rhône Alpes. Il a été directeur du Liama, le laboratoire sino-européen en informatique, automatique et mathématiques appliquées de Beijing. L’essentiel de sa recherche concerne les questions globales, et notamment comment le numérique modifie les rapports entre les nations et oriente les sociétés dans l’adaptation aux changements écosystémiques. Nous l’avons interviewé notamment pour mieux comprendre ce qui se passe en Chine autour du numérique et des communs numériques.
Peux-tu nous parler de ton activité professionnelle actuelle ?
Depuis quelques temps, je fais moins de technique et plus de géopolitique. Je m’intéresse au numérique et pour moi le numérique est un système de pouvoir qui implique de nouveaux rapports de force entre les personnes et les pays. Je reste fasciné par le regard que les Européens portent sur la Chine. Ils ne voient dans la stratégie chinoise que l’aspect surveillance de sa population alors que cette stratégie est fondée sur la souveraineté numérique. Les États-Unis ont aussi un système de surveillance du même type et les Américains ont bien saisi la question de souveraineté numérique.
A l’École Normale Supérieure de Lyon, je travaille avec des gens qui étudient les systèmes complexes, sur la prise de conscience de changements de société causés par la transition numérique, ses imbrications avec la transition écologique. Il y a des anthropologues et des juristes ce qui me permet d’élargir mon horizon.
Où est-ce qu’on publie dans ce domaine ?
Ce n’est pas facile. Sur cet aspect, je regrette le temps où ma recherche était plus technique ; je savais alors précisément où publier. Par exemple, sur les aspects plus politiques du développement durable, il n’est pas facile de trouver le bon support.

Parle nous d’un de tes sujets de prédilections, la Chine.
Je voudrais en préambule proposer une analyse globale de la situation. Contrairement à la vision qui mettrait la Chine d’un côté et le monde occidental de l’autre, le monde numérique se sépare entre Chine et États-Unis d’un côté et de l’autre l’Europe.
Entre la Chine et les États-Unis, une différence est la liberté d’expression. Aux États-Unis, cette liberté fait l’objet du premier amendement de la constitution, c’est dire son importance. En Chine, le sujet n’existe pas. Il y a une forme de possibilité de critiquer, mais la critique doit se faire de biais, jamais directement. L’expression critique reste typiquement métaphorique, mais les Chinois la comprennent bien. Depuis l’ère Trump, les Américains ont essayé de bloquer le développement numérique chinois. Deux idées sont importantes : la souveraineté et l’extension extraterritoriale. Ce sont les bases du conflit États-Unis et Chine.
Actuellement la tension monte de manière inquiétante. Des deux côtés, un processus de désimbrication intellectuelle et technologique est enclenché. C’est une mauvaise nouvelle globalement car c’est le chemin vers des conflits.
La pensée numérique s’est beaucoup développée en Chine, qui est devenue depuis un certain temps précurseur au niveau mondial. Aux États-Unis, les liens entre l’industrie numérique et l’État sont importants, mais se cantonnent principalement à la sécurité. En Chine en revanche, cela va plus loin : le rôle stratégique des plateformes numériques est mieux reconnu et plus large, dans l’économie, le social, au-delà de la simple surveillance. C’est ce qui donne au pays une avance sur le reste du monde.
La Chine est aujourd’hui dans une phase de définition des rapports de force entre les plateformes et l’État. Les États-Unis feront la même chose, mais probablement plus tard. Le dogme dominant aujourd’hui est que la régulation nuirait à l’innovation et à la sécurité nationale. En Chine, la définition de ces rapports est dictée par l’État : c’est une décision politique de l’État.
Par ailleurs, on assiste actuellement à un durcissement politique en Chine, une baisse de la liberté de critique et une moins grande ouverture. L’instabilité sociale potentielle pousse à une politique de redistribution des richesses. Une forte régulation des plateformes a été lancée depuis l’arrêt brutal de l’IPO d’Ant Financial l’année dernière. Ces régulations touchent aussi les plateformes de la EdTech, avec des arguments de justice sociale également.
Comment arrives-tu à t’informer sur la Chine ?
C’est devenu plus difficile parce que malheureusement on ne peut plus y aller à cause de la politique de protection face au Covid. Mais il se publie beaucoup de choses en Chine qui sont accessibles.
Est-ce qu’il y a des sites de données ouvertes en Chine ?
Oui il y a par exemple des équivalents de data.gouv en Chine, beaucoup au niveau des provinces et des villes. En matière de données ouvertes, la politique chinoise est différente de celle que nous connaissons en Europe. Plutôt que d’ouvrir les données et d’attendre que des acteurs s’en saisissent, on procède en ciblant des acteurs précis pour réaliser des services innovants à partir potentiellement d’un cahier des charges, sous contrôle de l’administration publique. L’ouverture se fait dans le cadre d’appels d’offres comme c’est le cas, par exemple, à Shanghai. Bien sûr, comme ailleurs, on assiste à des résistances, des villes qui hésitent à ouvrir leurs données.
Il faut aussi parler des expérimentations mettant en œuvre le social scoring, une notation sociale. Il s’agit de mesurer la “responsabilité citoyenne” de chacun ou de chacune, suivant les bonnes ou les mauvaises actions qu’il ou elle commet. C’est aujourd’hui très expérimental, mais différentes villes l’ont déjà implémenté.
Il faut bien réaliser que la frontière entre espace public et privé est plus floue en Chine que chez nous. Par exemple, la circulation des voitures est monitorée et les PV sont mis automatiquement, ils sont visibles sur un site en ligne. Il faut avoir une vignette qui atteste de sa capacité à conduire et avoir bien payé ses PV. Cette approche est similaire à ce qui se pratique aux États-Unis avec le financial scoring qui est largement utilisé. Les Chinois sont globalement bienveillants face aux développements numériques et ils font preuve d’un “pragmatisme décontracté” à son égard. Les données personnelles ne sont pas accessibles à tous, et une nouvelle législation est entrée en vigueur au mois de novembre 2021, inspirée du RGPD.

Est-ce qu’il y a des plateformes basées sur les communs numériques comme Wikipedia ou OpenStreetMap ?
Oui des analogues existent. Il y a un équivalent de Wikipédia réalisé par Baidu, et des équivalents locaux d’OpenStreetMap. Sur les pages Wikipédia en chinois les points de vue ne sont pas toujours ceux des autorités. C’est parfois censuré mais les gens savent souvent contourner la censure.
Et pour ce qui est des logiciels libres ?
L’open source est relativement présent. La tech peut parfois avoir des accents libertaires qui la mettent en opposition avec les autorités. Mais l’État chinois sait se servir de l’open source en particulier comme outil de souveraineté numérique. Le système d’exploitation Harmony de Huawei (basé sur Android) est bien un enjeu de la lutte entre la Chine et les États-Unis pour la dominance technologique et le découplage des économies numériques.
Plus généralement, que peut-on dire sur les communs numériques en Chine ?
Il n’y aurait aucun sens à ne pas profiter de tels communs en Chine comme en France. D’ailleurs, ces communs sont fortement développés en Chine, plus que dans d’autres pays. Les données accumulées par les plateformes en Occident ne sont utilisées que par celles-ci pour un intérêt mercantile, au-delà de la sécurité. Mais ces données peuvent être vues comme des communs, dont l’usage doit être encadré bien sûr par exemple par l’anonymisation.
Si on regarde bien, Google dispose de données stratégiques pour un grand nombre de sujets au-delà de la sécurité comme la santé, l’économie ou l’éducation. Pourtant aux États-Unis et en Europe, les relations entre l’État et les plateformes sont focalisées sur la sécurité. Cela fait passer à côté de nombreuses opportunités. En Chine, tous les sujets sont abordés en s’appuyant sur les services numériques, y compris par exemple la grogne sociale. Avec ces services, on peut détecter un problème régional et procéder au remplacement d’un responsable.
La Chine construit une société numérique nouvelle, et exploite les données pour la gouvernance. En ce sens, elle est en avance sur le reste du monde.
Et quelle est la place de l’Europe dans tout ça ?
Pour l’Europe, la situation est différente. Contrairement à la Chine ou aux États-Unis, elle n’a ni technologie ni plateforme. Elle est donc dépendante sur ces deux dimensions et essaie de compenser par la régulation. Mais sa régulation est focalisée sur la protection de l’individu, pas du tout sur les communs ou l’intérêt global de la société. L’Europe n’a aucune souveraineté numérique et ses outils et services n’ont pas de portée extraterritoriale, parce qu’elle n’a pas d’outils de taille mondiale.
Pour les Chinois, l’Europe n’existe plus : les cadres chinois voient l’Europe comme nous voyons la Grèce, une région qui a compté dans l’histoire mais qui ne pèse plus au niveau politique et stratégique, sympa pour les vacances. Je ne suis pas sûr que la vision des américains soit très différente de celle des Chinois d’ailleurs.
La stratégie chinoise des routes de la soie, une infrastructure absolument géniale du gouvernement Chinois, contribuera d’ailleurs à augmenter la dépendance de l’Europe vis à vis de la Chine, à long terme peut-être dans un équilibre avec les États-Unis, voire dans une séparation de l’Europe dans deux zones d’influence comme c’était le cas pendant la guerre froide.
Serge Abiteboul, Inria et ENS, Paris, & François Bancilhon, serial entrepreneur
https://binaire.socinfo.fr/page-les-communs-numeriques/



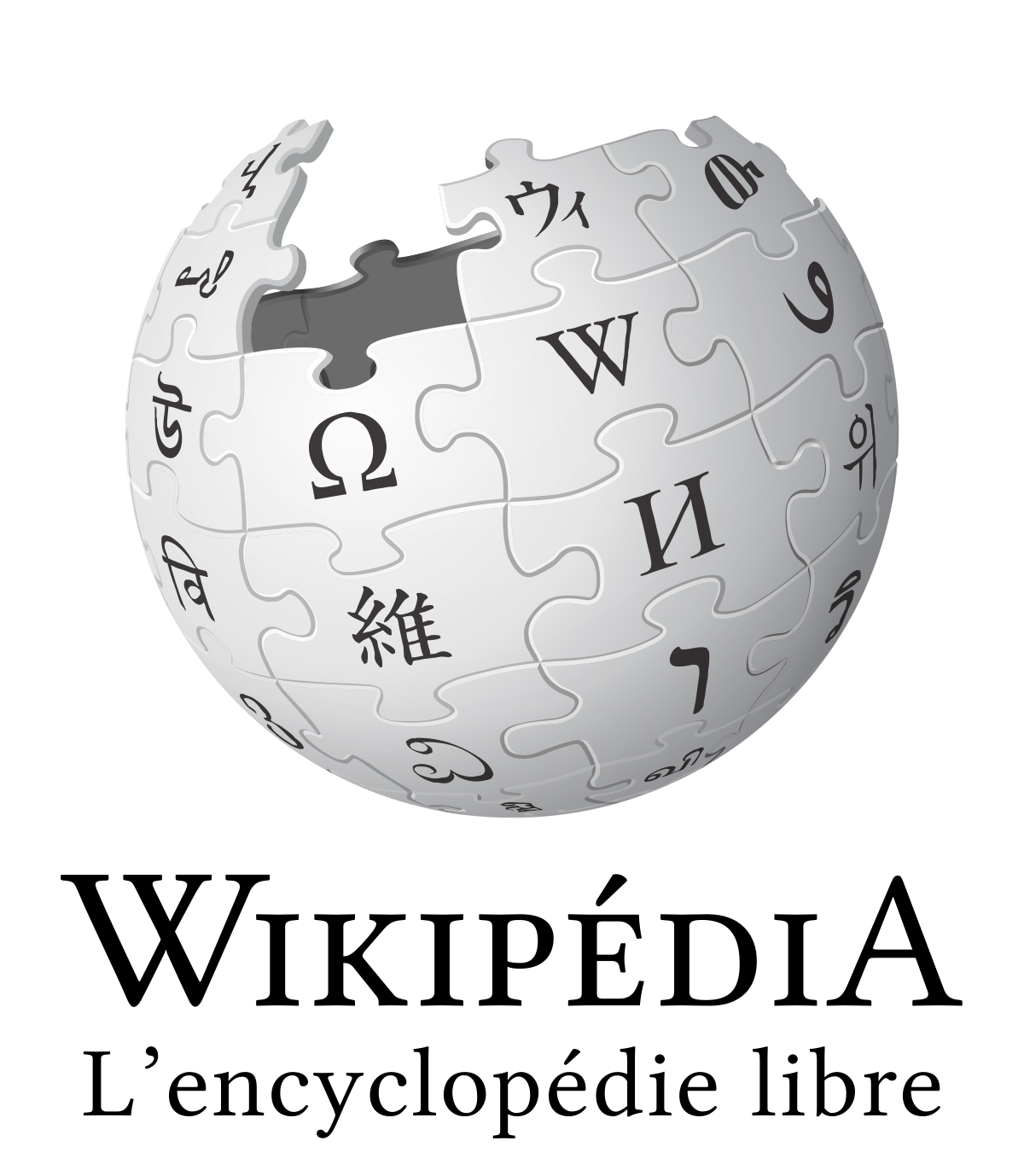 J’ai notamment beaucoup discuté sur un forum avec un activiste de GreenPeace. C’est lui qui m’a fait découvrir Wikipédia qui démarrait à ce moment. Il m’a suggéré d’y raconter ce qui me tenait à cœur, sur la version anglophone. A cette époque, il n’y avait encore quasiment personne sur Wikipédia en français.
J’ai notamment beaucoup discuté sur un forum avec un activiste de GreenPeace. C’est lui qui m’a fait découvrir Wikipédia qui démarrait à ce moment. Il m’a suggéré d’y raconter ce qui me tenait à cœur, sur la version anglophone. A cette époque, il n’y avait encore quasiment personne sur Wikipédia en français. binaire : La fondation Wikimédia promeut d’autres services que l’encyclopédie Wikipédia. Vous pouvez nous en parler ?
binaire : La fondation Wikimédia promeut d’autres services que l’encyclopédie Wikipédia. Vous pouvez nous en parler ?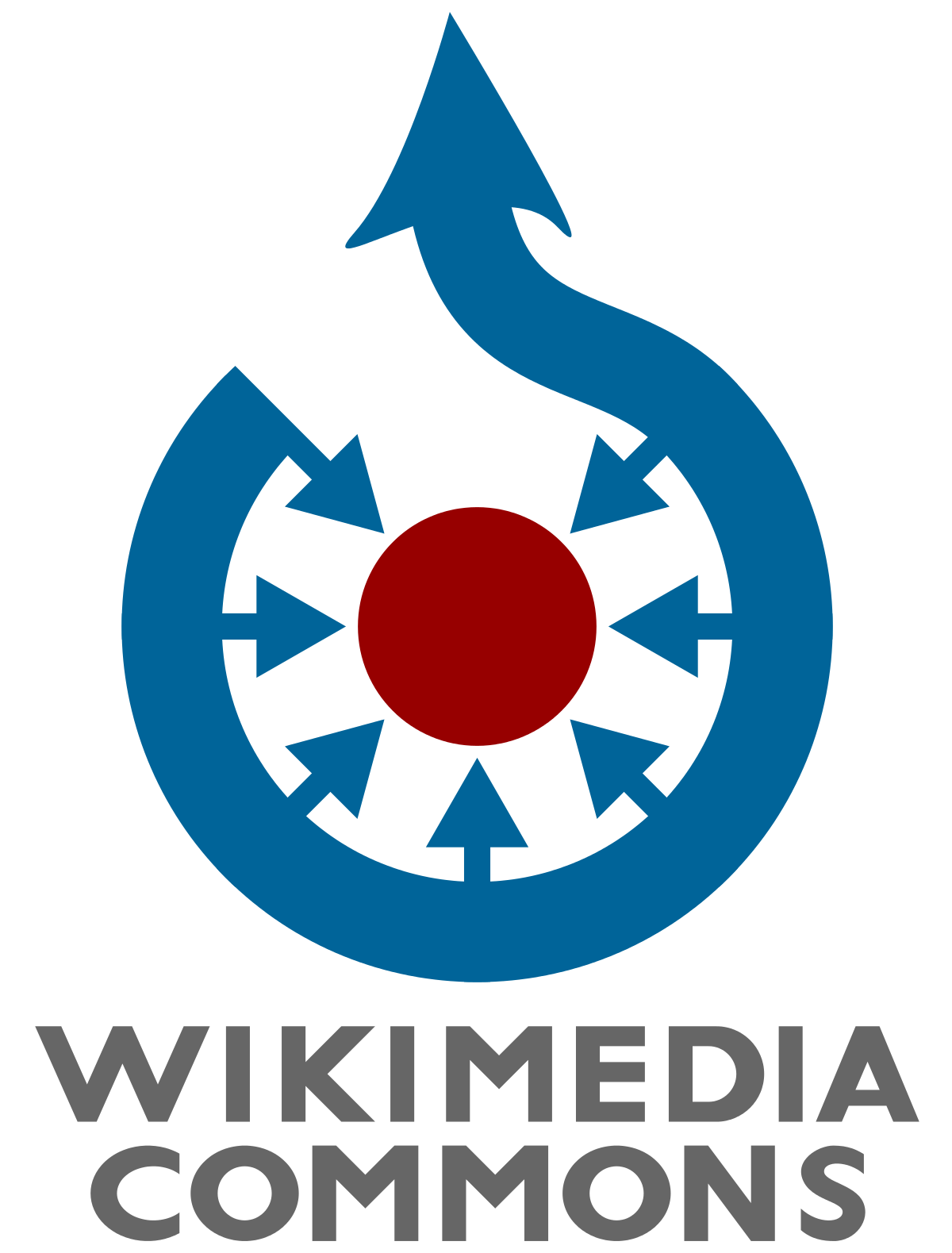 Un autre projet très populaire, c’est Wikimedia Commons qui regroupe des millions d’images. C’est né de l’idée qu’il était inutile de stocker la même image dans plusieurs encyclopédies dans des langues différentes. Je trouve très sympa dans Wikimedia Commons que nous travaillions tous ensemble par-delà des frontières linguistiques, que nous arrivions à connecter les différentes versions linguistiques.
Un autre projet très populaire, c’est Wikimedia Commons qui regroupe des millions d’images. C’est né de l’idée qu’il était inutile de stocker la même image dans plusieurs encyclopédies dans des langues différentes. Je trouve très sympa dans Wikimedia Commons que nous travaillions tous ensemble par-delà des frontières linguistiques, que nous arrivions à connecter les différentes versions linguistiques.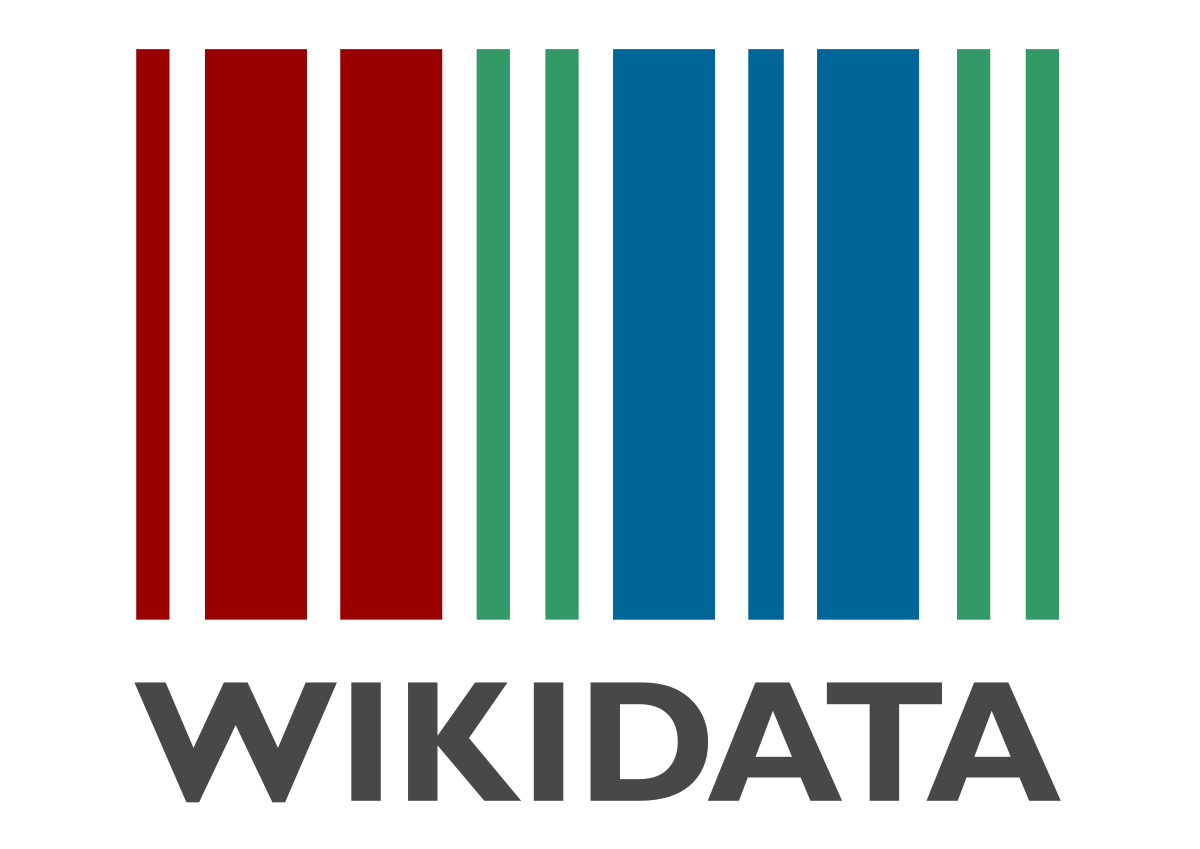 Un troisième projet, Wiki Data construit une base de connaissances. Le sujet est plutôt d’ordre technique. Cela consiste en la construction de bases de faits comme « “Napoléon” est mort à “Sainte Hélène” ». À une entité comme ”Napoléon”, on associe tout un ensemble de propriétés qui sont un peu agnostiques de la langue. Les connaissances sont ajoutées par des systèmes automatiques depuis d’autres bases de données ou entrées à la main par des membres de la communauté wikimédienne. On peut imaginer de super applications à partir de Wiki Data.
Un troisième projet, Wiki Data construit une base de connaissances. Le sujet est plutôt d’ordre technique. Cela consiste en la construction de bases de faits comme « “Napoléon” est mort à “Sainte Hélène” ». À une entité comme ”Napoléon”, on associe tout un ensemble de propriétés qui sont un peu agnostiques de la langue. Les connaissances sont ajoutées par des systèmes automatiques depuis d’autres bases de données ou entrées à la main par des membres de la communauté wikimédienne. On peut imaginer de super applications à partir de Wiki Data.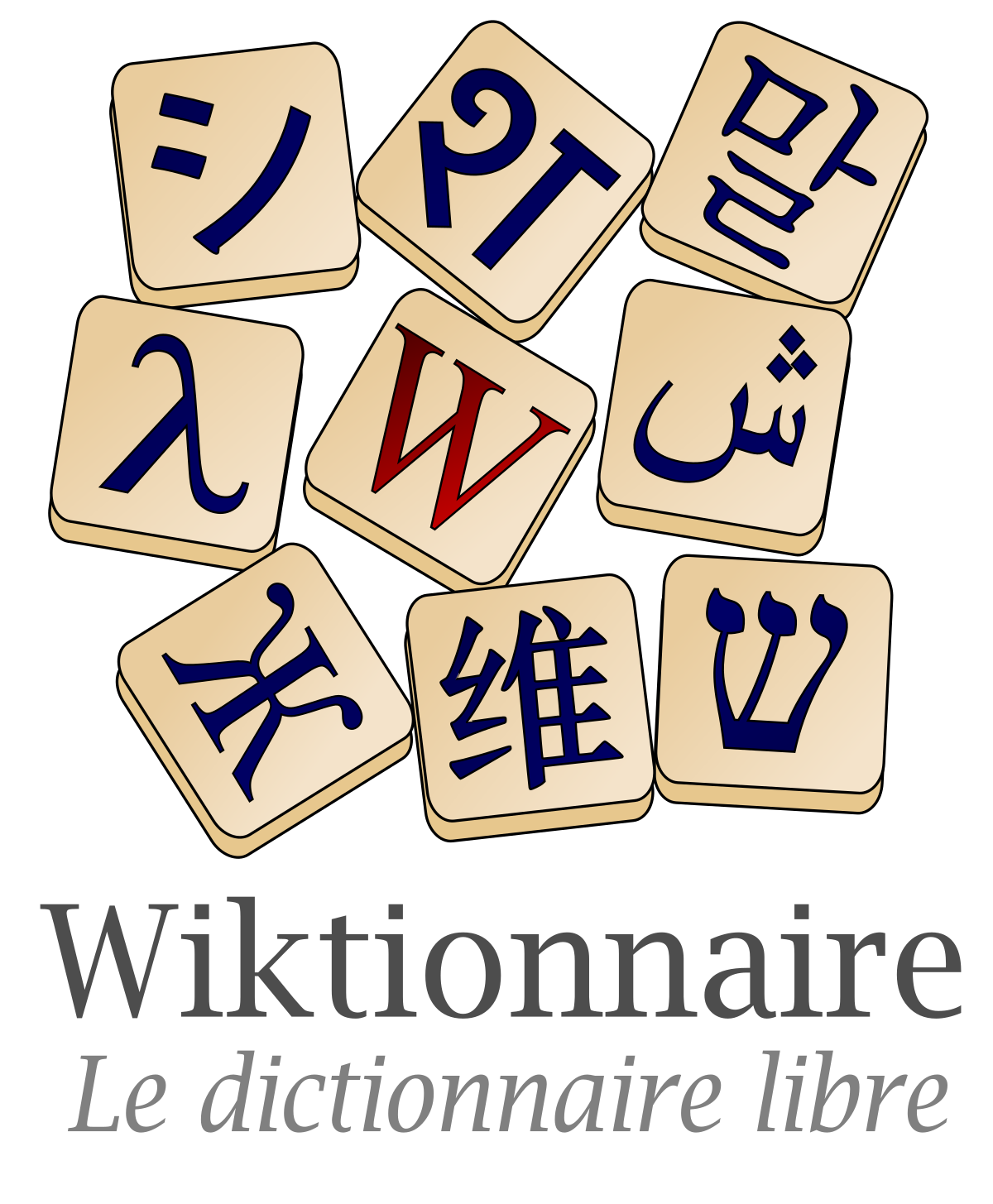 FD : Au début, on avait juste l’encyclopédie. La Fondation a été créée en 2003, mais sans véritablement de stratégie. On faisait ce que les gens avaient envie de faire. Par exemple, Wiktionnaire a été créé à cette époque. On avait des entrées qui étaient juste des définitions de mots. On se disputait pour savoir si elles avaient leur place ou pas dans Wikipédia. Comme on ne savait pas comment trancher le sujet, on a créé autre chose : le Wiktionnaire. Dans cette communauté, quand tu as une bonne idée, tu trouves toujours des développeurs. Les projets se faisaient d’eux-mêmes, du moment que suffisamment de personnes estimaient que c’était une belle idée. Il n’y avait pas de stratégie établie pour créer ces projets.
FD : Au début, on avait juste l’encyclopédie. La Fondation a été créée en 2003, mais sans véritablement de stratégie. On faisait ce que les gens avaient envie de faire. Par exemple, Wiktionnaire a été créé à cette époque. On avait des entrées qui étaient juste des définitions de mots. On se disputait pour savoir si elles avaient leur place ou pas dans Wikipédia. Comme on ne savait pas comment trancher le sujet, on a créé autre chose : le Wiktionnaire. Dans cette communauté, quand tu as une bonne idée, tu trouves toujours des développeurs. Les projets se faisaient d’eux-mêmes, du moment que suffisamment de personnes estimaient que c’était une belle idée. Il n’y avait pas de stratégie établie pour créer ces projets.