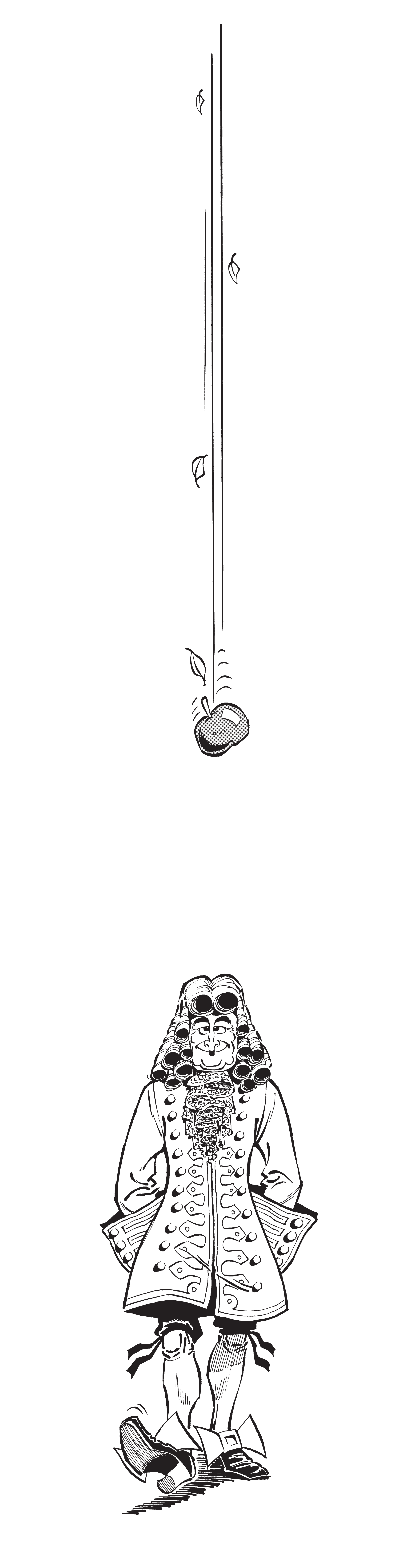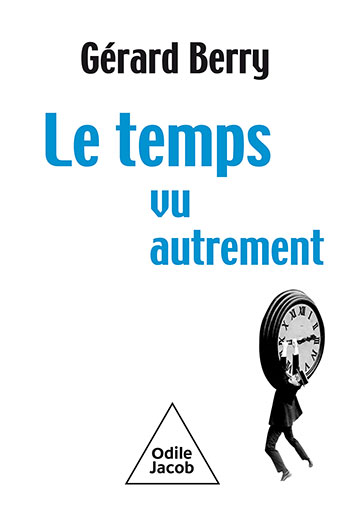| Charles Cuvelliez et Jean-Jacques Quisquater nous proposent en collaboration avec le Data Protection Officer de la Banque Belfius ; Francis Hayen, une discussion sur le dilemme entre le RGPD et la mise en place de caméra augmentée à l’IA pour diminuer le nombre de vols, les oublis, le sous-pesage aux caisses automatiques des supermarchés, qui sont bien nombreux. Que faire pour concilier ce besoin effectif de contrôle et le respect du RGPD ? Et bien la CNIL a émis des lignes directrices, d’aucun diront désopilantes, mais pleines de bon sens. Amusons-nous à les découvrir. Benjamin Ninassi et Thierry Viéville. |

C’est le fléau des caisses automatiques des supermarchés : les fraudes ou les oublis, pudiquement appelées démarques inconnues, ou la main lourde qui pèse mal fruits et légumes. Les contrôles aléatoires semblent impuissants. Dans certaines enseignes, il y a même un préposé à la balance aux caisses automatiques. La solution ? L’IA pardi. Malgré le RGPD ? Oui dit la CNIL dans une note de mai 2025.
Cette IA, ce sont des caméras augmentées d’un logiciel d’analyse en temps réel. On les positionne en hauteur pour ne filmer que l’espace de la caisse, mais cela inclut le client, la carte de fidélité, son panier d’achat et les produits à scanner et forcément le client, flouté de préférence. L’algorithme aura appris à reconnaitre des « événements » (identifier ou suivre les produits, les mains des personnes, ou encore la position d’une personne par rapport à la caisse) et contrôler que tout a bien été scanné. En cas d’anomalie, il ne s’agit pas d’arrêter le client mais plus subtilement de programmer un contrôle ou de gêner le client en lui lançant une alerte à l’écran, propose la CNIL qui ne veut pas en faire un outil de surveillance en plus. Cela peut marcher, en effet.
C’est que ces dispositifs collectent des données personnelles : même en floutant ou masquant les images, les personnes fautives sont ré-identifiables, puisqu’il s’agira d’intervenir auprès de la personne. Et il y a les images vidéo dans le magasin, non floutées. La correspondance sera vite faite.

Mais les supermarchés ont un intérêt légitime, dit la CNIL, à traiter ces données de leurs clients (ce qui les dispense de donner leur consentement) pour éviter les pertes causées par les erreurs ou les vols aux caisses automatiques. Avant d’aller sur ce terrain un peu glissant, la CNIL cherche à établir l’absence d’alternative moins intrusive : il n’y en a pas vraiment. Elle cite par exemple les RFID qui font tinter les portiques mais, si c’est possible dans les magasins de vêtements, en supermarché aux milliers de référence, cela n’a pas de sens. Et gare à un nombre élevé de faux positifs, auxquels la CNIL est attentive et elle a raison : être client accusé à tort de frauder, c’est tout sauf agréable. Cela annulera la légitimité de la méthode.
Expérimenter, tester
Il faut qu’un tel mécanisme, intrusif, soit efficace : la CNIL conseille aux enseignes de le tester d’abord. Cela réduit-il les pertes de revenus dans la manière dont le contrôle par IA a été mis en place ? Peut-on discriminer entre effet de dissuasion et erreurs involontaires pour adapter l’intervention du personnel ? Il faut restreindre le périmètre de prise de vue de la caméra le plus possible, limiter le temps de prise de vue (uniquement lors de la transaction) et la stopper au moment de l’intervention du personnel. Il faut informer le client qu’une telle surveillance a lieu et lui donner un certain contrôle sur son déclenchement, tout en étant obligatoire (qu’il n’ait pas l’impression qu’il est filmé à son insu), ne pas créer une « arrestation immédiate » en cas de fraude. Il ne faut pas garder ces données à des fins de preuve ou pour créer une liste noire de clients non grata. Pas de son enregistré, non plus. Ah, si toutes les caméras qui nous espionnent pouvaient procéder ainsi ! C’est de la saine minimisation des données.
Pour la même raison, l’analyse des données doit se faire en local : il est inutile de rapatrier les données sur un cloud où on va évidemment les oublier jusqu’au moment où elles fuiteront.
Le client peut s’opposer à cette collecte et ce traitement de données mais là, c’est simple, il suffit de prévoir des caisses manuelles mais suffisamment pour ne pas trop attendre, sinon ce droit d’opposition est plus difficilement exerçable, ce que n’aime pas le RGPD. D’aucuns y retrouveront le fameux nudge effect de R. Thaler (prix Nobel 2017) à savoir offrir un choix avec des incitants cognitifs pour en préférer une option plutôt que l’autre (sauf que l’incitant est trop pénalisant, le temps d’attente).
Réutilisation des données pour entrainement

Autre question classique dès qu’on parle d’IA : peut-on réutiliser les données pour entrainer l’algorithme, ce qui serait un plus pour diminuer le nombre de faux positifs. C’est plus délicat : il y aura sur ces données, même aux visages floutés, de nombreuses caractéristiques physiques aux mains, aux gestes qui permettront de reconnaitre les gens. Les produits manipulés et achetés peuvent aussi faciliter l’identification des personnes. Ce serait sain dit la CNIL de prévoir la possibilité pour les personnes de s’y opposer et dans tous les autres cas, de ne conserver les données que pour la durée nécessaire à l’amélioration de l’algorithme.
Les caisses automatiques, comme les poinçonneuses de métro, les péages d’autoroute, ce sont des technologies au service de l’émancipation d’une catégorie d’humains qui ont la charge de tâches pénibles, répétitives et ingrates. Mais souvent les possibilités de tricher augmentent de pair et il faut du coup techniquement l’empêcher (sauter la barrière par ex.). L’IA aux caisses automatiques, ce n’est rien de neuf à cet égard.

Mine de rien, toutes ces automatisations réduisent aussi les possibilités de contact social. La CNIL n’évoque pas l’alternative d’une surveillance humaine psychologiquement augmentée, sur place, aux caisses automatiques : imaginez un préposé qui tout en surveillant les caisses, dialogue, discute, reconnait les habitués. C’est le contrôle social qui prévient bien des fraudes.
Quand on sait la faible marge que font les supermarchés, l’IA au service de la vertu des gens, avec toutes ces précautions, n’est-ce pas une bonne chose ?
Charles Cuvelliez (Ecole Polytechnique de Bruxelles, Université de Bruxelles), Francis Hayen, Délégué à la Protection des Données & Jean-Jacques Quisquater (Ecole Polytechnique de Louvain, Université de Louvain et MIT).
Pour en savoir plus :

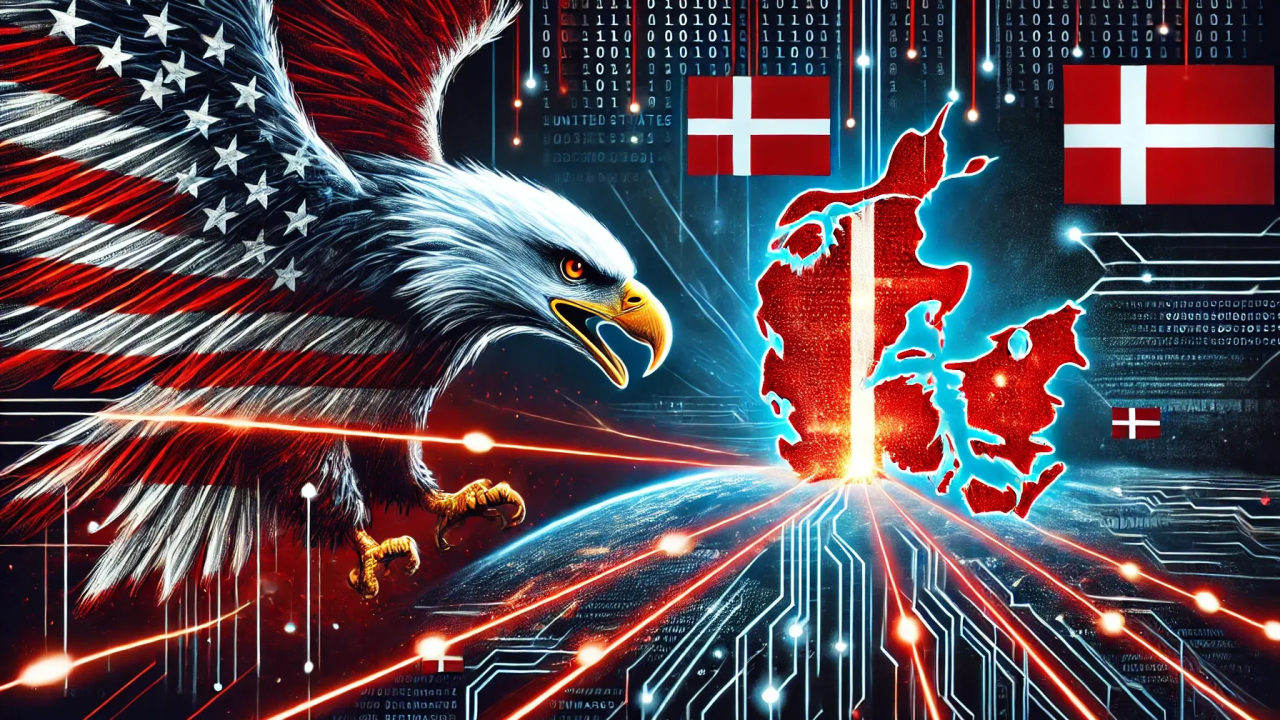
 Notre collègue du Cnam, Stéphane Natkin, Prof émérite, suite à l’écoute sur France Inter de Madame Virginie Schwarz, directrice de Météo France à propos du remplacement des modèles mathématiques de prévision par des modèles d’IA… a imaginé ce petit conte. Pierre Paradinas & Thierry Viéville.
Notre collègue du Cnam, Stéphane Natkin, Prof émérite, suite à l’écoute sur France Inter de Madame Virginie Schwarz, directrice de Météo France à propos du remplacement des modèles mathématiques de prévision par des modèles d’IA… a imaginé ce petit conte. Pierre Paradinas & Thierry Viéville.