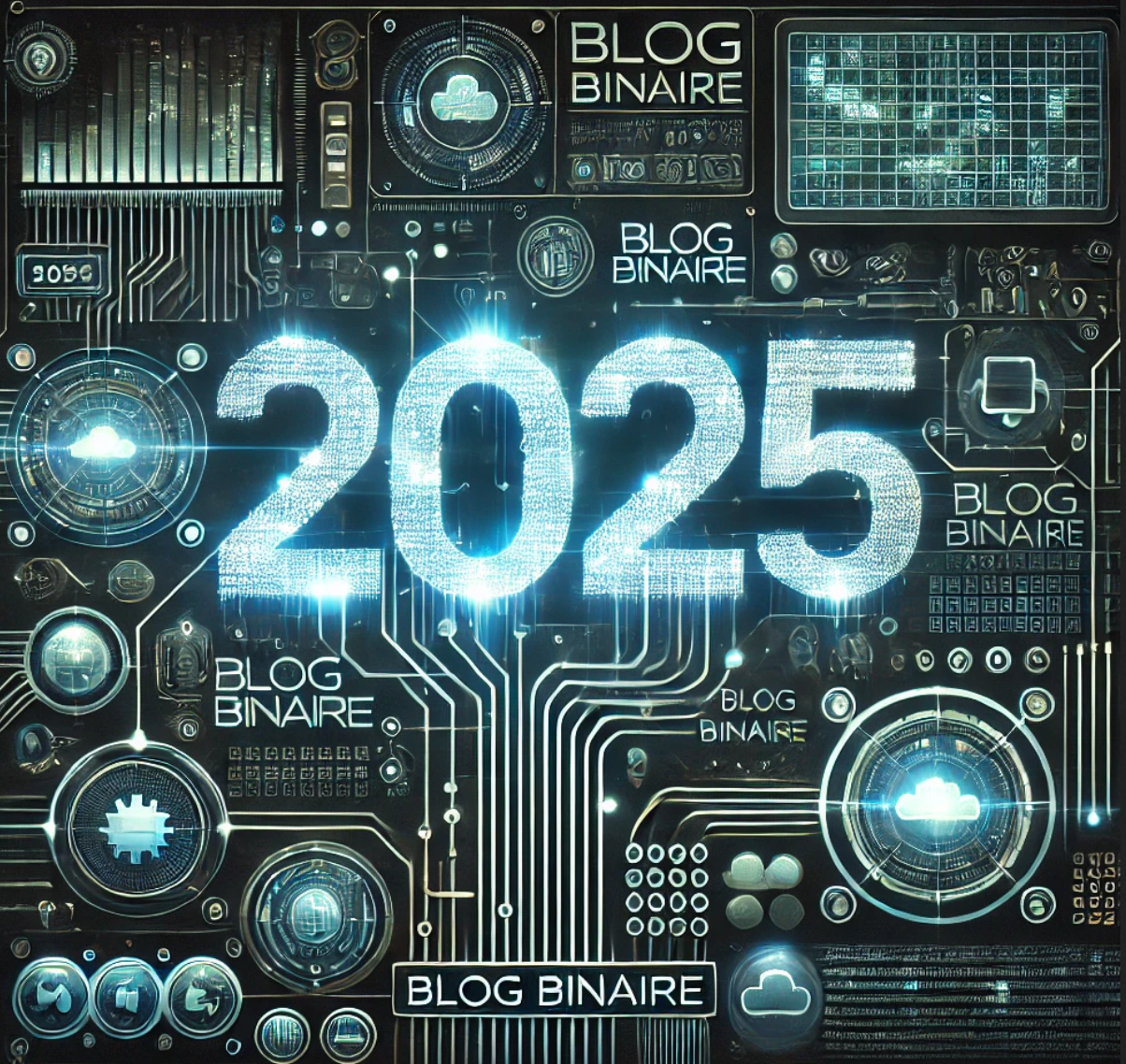A l’heure où Elon Musk fait un peu n’importe quoi au nom de la liberté d’expression, quand des grands patrons du numérique lui emboîtent le pas sans doute pour pousser leurs intérêts économiques, il devient encore plus indispensable de comprendre les mécanismes qui causent des dysfonctionnements majeurs des plateformes numériques. Ce premier épisode d’un article de Fabien Gandon et Franck Michel nous aide à mieux comprendre. Serge Abiteboul & Thierry Viéville.

Nous sommes un dimanche après-midi. Vous avez un petit moment pour vous. Vous pourriez lire, vous balader, aller courir ou écouter de la musique mais machinalement votre main saisit votre téléphone. Le « sombre miroir » s’éclaire et vous passez de l’autre côté. Vous ouvrez l’application de votre réseau social préféré qui vient de vous notifier qu’elle a du nouveau pour vous. Et c’est vrai ! Jean a posté un message à propos de la tragicomédie « Qui a hacké Garoutzia ? » qu’il a vue au théâtre hier soir. Vous approuvez ce poste d’un pouce virtuel et déjà votre vrai pouce pousse vers le poste suivant. Entre une publicité pour un abonnement au théâtre, une photo postée d’Avignon par un ami que vous avez du mal à remettre, l’annonce pour un jeu où tester vôtre culture générale… votre pouce se lance dans un jogging numérique effréné. Imperceptiblement le flux d’information qui vous est proposé dévie, une vidéo de chats acrobates, un « clash » entre stars de la télévision, une manifestation qui tourne à l’affrontement… Et avant que vous ne le réalisiez une petite heure s’est écoulée et il est maintenant trop tard pour un vrai jogging. Vous ressentez une certaine résistance à reposer votre téléphone : après tout, il y avait peut-être encore tant de contenus intéressants, inédits, surprenants ou croustillants dans ce fil de recommandations. Mais vous devez vous rendre à l’évidence, ce fil est sans fin. Vous ne pouvez croire à quelle vitesse la dernière heure est passée. Vous avez l’impression qu’on vous l’a volée, que vous avez traversé un « tunnel temporel ». Sans même vous rappeler de ce que vous avez vu défiler, vous reposez ce téléphone un peu agacé en vous demandant… mais qui a hacké mon attention ?
A l’attention de tous…
Sir Tim Berner-Lee, récipiendaire du prix Turing pour avoir inventé le Web, a toujours considéré que les Web devait « être pour tout le monde », mais il a aussi partagé début 2024 un dialogue intérieur en deux articles à propos du Web : « Le dysfonctionnement des réseaux sociaux » et « Les bonnes choses ». Et oui… même le père du Web s’interroge gravement sur celui-ci et met face à face ce qu’il y a de meilleur et de pire sur le Web. Loin d’avoir réalisé l’idéal d’une communauté mondiale unie, Tim constate que des applications du Web comme les réseaux sociaux amplifient les fractures, la polarisation, la manipulation et la désinformation, menaçant démocraties et bien-être. Tout en reconnaissant les nombreuses vertus du Web (outils éducatifs, systèmes open source ou support à la souveraineté numérique), il nous propose de mettre l’accent sur la transparence, la régulation, et une conception éthique d’un Web et d’un Internet plus sûrs et responsables. Autrement dit, l’enjeu actuel est de préserver les richesses du Web tout en se protégeant de ses dérives.
Parmi ces dérives, on trouve le problème de la captation de notre attention, un sujet sur lequel nous voulons revenir dans ce billet ainsi que le suivant. C’est l’objet d’un de nos articles publié cette année à la conférence sur l’IA, l’éthique et à la société (AIES) de l’Association pour l’Avancement de l’Intelligence Artificielle (AAAI), que nous résumons ici. Le titre pourrait se traduire par « Prêtez attention : un appel à réglementer le marché de l’attention et à prévenir la gouvernance émotionnelle algorithmique ». Nous y appelons à des actions contre ces pratiques qui rivalisent pour capter notre attention sur le Web, car nous sommes convaincus qu’il est insoutenable pour une civilisation de permettre que l’attention soit ainsi gaspillée en toute impunité à l’échelle mondiale.
Attention à la march…andisation (de l’attention)
Si vous lisez cette phrase, nous avons déjà gagné une grande bataille, celle d’obtenir votre attention envers et contre toutes les autres sollicitations dont nous sommes tous l’objet : les publicités qui nous entourent, les « apps » dont les notifications nous assaillent jour et nuit, et tous les autres « crieurs numériques » que l’on subit au quotidien.
Depuis l’avènement de la consommation de masse dans les années 50, les médias et les publicitaires n’ont eu de cesse d’inventer des méthodes toujours plus efficaces pour capter notre attention et la transformer en revenus par le biais de la publicité. Mais ce n’était qu’un début… Au cours des deux dernières décennies, en s’appuyant sur la recherche en psychologie, en sociologie, en neurosciences et d’autres domaines, et soutenues par les avancées en intelligence artificielle (IA), les grandes plateformes du Web ont porté le processus de captation de l’attention à une échelle sans précédent. Basé presque exclusivement sur les recettes publicitaires, leur modèle économique consiste à nous fournir des services gratuits qui, en retour, collectent les traces numériques de nos comportements. C’est le célèbre “si c’est gratuit, c’est nous le produit” et plus exactement, ici, le produit c’est notre attention. Ces données sont en effet utilisées pour maximiser l’impact que les publicités ont sur nous, en s’assurant que le message publicitaire correspond à nos goûts, nos inclinations et notre humeur (on parle de “publicité ciblée”), mais aussi en mettant tout en place pour que nous soyons pleinement attentifs au moment où la publicité nous est présentée.
Recrutant des « armées » de psychologues, sociologues et neuroscientifiques, les plateformes du Web comme les médias sociaux et les jeux en ligne ont mis au point des techniques capables de piller très efficacement notre « temps de cerveau disponible ». Résultat, nous, les humains, avons créé un marché économique où notre attention est captée, transformée, échangée et monétisée comme n’importe quelle matière première sur les marchés.
Faire, littéralement, attention
A l’échelle individuelle, lorsque l’on capte notre attention à notre insu, on peut déjà s’inquiéter du fait que l’on nous vole effectivement du temps de vie, soit l’un de nos biens les plus précieux. Mais si l’attention est un mécanisme naturel au niveau individuel, l’attention collective, elle, est le fruit de l’action de dispositifs spécifiques. Il peut s’agir de lieux favorisant l’attention partagée (ex. un théâtre, un cinéma, un bar un soir de match, une exposition), de l’agrégation d’attention individuelle pour effectuer des mesures (ex. audimat, nombre de vues, nombre de partages, nombre de ventes, nombre d’écoutes, etc.) ou autres. Pour ce qui est de l’attention collective, nous faisons donc, littéralement, l’attention. En particulier, les plateformes créent l’attention collective et dans le même temps captent ce commun afin de le commercialiser sans aucune limite a priori.
Parmi les techniques utilisées pour capter notre attention, nous pouvons distinguer deux grandes catégories. Tout d’abord, certaines techniques sont explicitement conçues pour utiliser nos biais cognitifs. Par exemple, les likes que nous recevons après la publication d’un contenu activent les voies dopaminergiques du cerveau (impliquées dans le système de récompense) et exploitent notre besoin d’approbation sociale ; les notifications des apps de nos smartphones alimentent notre appétit pour la nouveauté et la surprise, de sorte qu’il est difficile d’y résister ; le « pull-to-refresh », à l’instar des machines à sous, exploite le modèle de récompense aléatoire selon lequel, chaque fois que nous abaissons l’écran, nous pouvons obtenir une nouveauté, ou rien du tout ; le défilement infini (d’actualités, de posts ou de vidéos…) titille notre peur de manquer une information importante (FOMO), au point que nous pouvons difficilement interrompre le flux ; l’enchaînement automatique de vidéos remplace le choix délibéré de continuer à regarder par une action nécessaire pour arrêter de regarder, et provoque un sentiment frustrant d’incomplétude lorsqu’on l’arrête ; etc. De même, certaines techniques exploitent des « dark patterns » qui font partie de ce qu’on nomme design compulsogène ou persuasif, pour nous amener, malgré nous, à faire des actions ou des choix que nous n’aurions pas faits autrement. C’est typiquement le cas lorsque l’on accepte toutes les notifications d’une application sans vraiment s’en rendre compte, alors que la désactivation des notifications nécessiterait une série d’actions fastidieuses et moins intuitives.
Les petites attentions font les grandes émotions… oui mais lesquelles?
Une deuxième catégorie de techniques utilisées pour capter notre attention repose sur les progrès récents en matière d’apprentissage automatique permettant d’entraîner des algorithmes de recommandation de contenu sur des données comportementales massives que Shoshana Zuboff appelle le « surplus comportemental« . Ces algorithmes apprennent à recommander des contenus qui non seulement captent notre attention, mais également augmentent et prolongent notre « engagement » (le fait de liker, commenter ou reposter des contenus, et donc d’interagir avec d’autres utilisateurs). Ils découvrent les caractéristiques qui font qu’un contenu attirera plus notre attention qu’un autre, et finissent notamment par sélectionner des contenus liés à ce que Gérald Bronner appelle nos invariants mentaux : la conflictualité, la peur et la sexualité. En particulier, les émotions négatives (colère, indignation, ressentiment, frustration, dégoût, peur) sont parmi celles qui attirent le plus efficacement notre attention, c’est ce que l’on appelle le biais de négativité. Les algorithmes apprennent ainsi à exploiter ce biais car les contenus qui suscitent ces émotions négatives sont plus susceptibles d’être lus et partagés que ceux véhiculant d’autres émotions ou aucune émotion particulière. Une véritable machine à créer des “réseaux soucieux” en quelque sorte.
Bulles d’attention et bulles de filtres
En nous promettant de trouver pour nous ce qui nous intéresse sur le Web, les algorithmes de recommandation ont tendance à nous enfermer dans un espace informationnel conforme à nos goûts et nos croyances, une confortable bulle de filtre qui active notre biais de confirmation puisque nous ne sommes plus confrontés à la contradiction, au débat ou à des faits ou idées dérangeants.
En apparence bénignes, ces bulles de filtres ont des conséquences préoccupantes. Tout d’abord, au niveau individuel, parce que, s’il est important de se ménager des bulles d’attention pour mieux se concentrer et résister à l’éparpillement, il est aussi important de ne pas laisser d’autres acteurs décider quand, comment et pourquoi se forment ces bulles. Or c’est précisément ce que font les algorithmes de recommandation et leurs bulles de filtres, en décidant pour nous à quoi nous devons penser.
Ensuite, au niveau collectif, Dominique Cardon pointe le fait que les bulles de filtres séparent les publics et fragmentent nos sociétés. Ceux qui s’intéressent aux informations sont isolés de ceux qui ne s’y intéressent pas, ce qui renforce notamment le désintérêt pour la vie publique.
Et en créant une vision du monde différente pour chacun d’entre nous, ces techniques nous enferment dans des réalités alternatives biaisées. Or vous et moi pouvons débattre si, alors que nous observons la même réalité, nous portons des diagnostiques et jugements différents sur les façons de résoudre les problèmes. Mais que se passe-t-il si chacun de nous perçoit une réalité différente ? Si nous ne partons pas des mêmes constats et des mêmes faits ? Le débat devient impossible et mène vite à un affrontement stérile de croyances, au sein de ce que Bruno Patino appelle une « émocratie, un régime qui fait que nos émotions deviennent performatives et envahissent l’espace public« . Dit autrement, il n’est plus possible d’avoir un libre débat contradictoire au sein de l’espace public, ce qui est pourtant essentiel au fonctionnement des démocraties.
La tension des émotions
Puisque les algorithmes de recommandation sélectionnent en priorité ce qui produit une réaction émotionnelle, ils invibilisent mécaniquement ce qui induit une faible réponse émotionnelle. Pour être visible, il devient donc impératif d’avoir une opinion, de préférence tranchée et clivante, de sorte que la réflexion, la nuance, le doute ou l’agnosticisme deviennent invisibles. L’équation complexe entre émotions, biais cognitifs et algorithmes de recommandation conduit à une escalade émotionnelle qui se manifeste aujourd’hui sur les médias sociaux par une culture du « clash », une hypersensibilité aux opinions divergentes interprétées comme des agressions, la polarisation des opinions voire la radicalisation de certains utilisateurs ou certaines communautés. Ce qui fait dire à Bruno Patino que « les biais cognitifs et les effets de réseau dessinent un espace conversationnel et de partage où la croyance l’emporte sur la vérité, l’émotion sur le recul, l’instinct sur la raison, la passion sur le savoir, l’outrance sur la pondération ». Recommandation après recommandation, amplifiée par la désinhibition numérique (le sentiment d’impunité induit par le pseudo-anonymat), cette escalade émotionnelle peut conduire à des déferlements de violence et de haine dont l’issue est parfois tragique, comme en témoignent les tentatives de suicide d’adolescents victimes de cyber-harcèlement. Notons que cette escalade est souvent encore aggravée par les interfaces des plateformes, qui tendent à rendre les échanges de plus en plus brefs, instinctifs et simplistes.
Le constat que nous dressons ici peut déjà sembler assez noir, mais il y a pire… Et à ce stade, pour garder votre attention avant que vous ne zappiez, quoi de mieux que de créer un cliffhanger, une fin laissée en suspens comme dans les séries télévisées à succès, et d’utiliser l’émotion qui naît de ce suspens pour vous hameçonner dans l’attente du prochain épisode, du prochain billet à votre attention…